
Adjacente à la manufacture de La Chaux-de-Fonds, la Maison des métiers d’art regroupe les plus précieux métiers d’art appliqués à l’horlogerie. Certains d’entre eux renaissent même au cœur de cet écrin.
Autrefois installée dans la manufacture du Crêt-du-Locle, l’entité regroupant les métiers d’art a établi ses nouveaux quartiers au cœur d’une ancienne ferme de style bernois datant de la fin du 18ème siècle et jouxtant le bâtiment principal. La nouvelle Maison des métiers d’art s’impose, par son architecture, comme le symbole d’une rencontre réussie entre tradition et modernité. Si l’esprit des lieux a été conservé, la structure intérieure a été entièrement reconçue et doublée d’une trame invisible hautement technique. La naissance de la Maison des métiers d’art s’inscrit comme un geste pionnier par lequel Cartier relève le défi de sublimer la tradition et d’ancrer dans la modernité ces pratiques expertes.
Au rez-de-chaussée
Les 350 m2 du rez-de-chaussée s’articulent autour du hall d’entrée et mènent vers le Grand salon, le Petit salon et la salle de présentations. La répartition de ce premier étage témoigne de la volonté de Cartier d’ouvrir ces métiers au partage et à l’échange: rencontres avec les artisans, visite des ateliers.
Entrer dans le Grand salon, c’est se sentir immédiatement replongé dans l’esprit d’autrefois. Les parois et les sols boisés - du sapin récupéré dans d’autres fermes alentours - créent une ambiance chaleureuse. La cheminée centrale évoque les frimas d’autrefois qui regroupaient toute la famille au bord de cet âtre réconfortant. Les fenêtres, puits de lumière mesurés, découvrent des espaces extérieurs verdoyants. Si le temps semble s’être arrêté dans cet espace, une pendule neuchâteloise rappelle pourtant aux visiteurs que l’heure tourne et qu’ils vivent bien au 21ème siècle.
Au premier étage
Ce premier étage abrite les métiers traditionnels comme le sertissage, la joaillerie ou encore le polissage. Une partie de cet espace est dédié au métier premier de Cartier, la joaillerie. Et qui dit joaillerie dit sertissage. Toutes les techniques sont appliquées, que ce soit le serti griffe, le serti descendu, le serti grain, le serti clos, etc. Le polissage est également déterminant car de lui dépend la brillance et l’éclat d’une pièce, mais aussi le confort du porté. Extrêmement technique, il requiert des années d’expérience et doit s’exercer avec maîtrise et patience.
Si les techniques traditionnelles occupent une large place, elles laissent toutefois aussi l’espace aux savoir-faire oubliés. Souvent transmis d’artisan en artisan, ces métiers du passé ont sombré dans l’oubli au fil du temps. Cartier s’est donné comme devoir de recenser, comprendre et faire évoluer ces trésors d’artisanat. Elle a ainsi remis au goût du jour deux techniques disparues: la granulation et le filigrane.
La granulation est apparue au troisième millénaire avant J.-C. Elle a trouvé toute la force de son expression au huitième siècle avant J.-C. avec l’art étrusque. Véritable semis de grains d’or, la technique de la granulation consiste à réaliser des billes à partir de fils d’or découpés, puis roulés dans de la poussière de charbon de bois et chauffés à la flamme. Les grains sont alors assemblés un à un et fusionnent avec la plaque d’or afin de créer le relief du motif. En 2013, Cartier a créé une montre en granulation au décor de panthère. Près de 3’800 billes d’or composent cette œuvre. Elles sont fixées au cadran par groupe de cinq. Près de 3’500 passages au feu ont été nécessaires à sa réalisation. Quarante heures furent consacrées à la gravure du motif et près de 320 heures à la mise en place des billes. Vingt pièces de ce chef-d’œuvre artistique ont été réalisées.
L’invention du filigrane est attribuée aux Sumériens. Les premiers objets créés selon cet art, en provenance de Troie et d’Ur, ont été datés de 3’000 ans avant J.-C. Les artisans ont dû adapter cette technique aux critères de la maison et à l’échelle de l’univers horloger. Aujourd’hui, les fils d’or ou de platine sont torsadés, puis aplatis par martelage. Ils sont ensuite modelés afin de former le motif, puis soudés. En 2015, Cartier réinvente cette technique et l’associe au travail de la laque et du sertissage. Le modèle Ronde Louis Cartier, décor panthères arbore ces techniques, dont le filigrane qui a nécessité quelque dix jours de travail. Vingt pièces ont également été éditées.
Au deuxième étage
Les techniques de la marqueterie, de la mosaïque et de l’émaillage se partagent cet étage. Techniques ancestrales très tôt présentes dans l’histoire, la marqueterie - de bois, de paille - ou la mosaïque de pierre s’appliquent aujourd’hui à l’échelle miniature des cadrans de montres Cartier. Le matériau est choisi pour sa couleur, sa texture, sa spécificité. Taillés en de minuscules éléments qui vont composer le motif, ces fragments sont assemblés à la main, au fil d’un travail d’une extrême minutie.
En 2014, une technique inédite en horlogerie s’est inscrite au répertoire de la maison, la marqueterie florale. Pour cette pratique aussi rare que délicate, les artisans effectuent une série d’opérations très minutieuses: la récolte des pétales, la coloration, le découpage de chaque pétale, apposé sur une fine épaisseur de bois, grâce à une scie à pied de marqueterie, dite «à arbalète». Une fois assemblés, ces éléments laissent apparaître le dessin dans son entier. Un travail d’une grande exigence, où tout se joue à chaque étape: il suffit d’un geste malencontreux et l’ensemble est à reprendre. Une prouesse qui nécessite une immense concentration et deux semaines de travail uniquement dédiées à la marqueterie. Trois autres semaines sont ensuite nécessaires pour réaliser le cadran de la montre Ballon Bleu marqueterie florale, décor perroquet.
Chez Cartier, deux techniques de mosaïque se complètent: des petits carrés miniatures apposés dans le fond du cadran et des tesselles aux formes irrégulières qui composent le motif. La composition est rigoureuse, les couleurs varient selon la nature des pierres. L’an dernier, Cartier a créé un cadran en mosaïque de pierre au motif de tigre. Une œuvre spectaculaire qui comptabilise près de 500 minuscules tesselles et entre 30 à 40 heures de travail pour le fond et 25 à 30 heures pour le décor.
Que seraient les métiers d’art sans l’émail? Email champlevé, émail plique-à-jour, émail grisaille, émail cloisonné, émail peint ou encore l’émail grisaille pâte d’or… Cette dernière technique consiste à recouvrir une plaque d’or d’une couche uniforme d’émail noir. L’artisan dépose ensuite, à l’aiguille ou au pinceau très fin, une pâte d’or qu’il va travailler pour créer des effets de profondeur et de relief. Le cadran est ensuite passé au four. Bel exemple de ce procédé, la montre Rotonde, décor panthère, éditée en 2014 à 80 exemplaires.
Parcourir la Maison des métiers d’art entraîne le visiteur dans un autre monde, un monde de magie et de rêve où les artisans rivalisent chaque jour d’ingéniosité pour faire renaître des savoir-faire oubliés, perfectionner ceux existants ou simplement innover!
02.4.2015
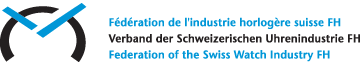

 News
News 
