Depuis le 9 octobre dernier, La Montre Hermès, à Bienne, abrite un atelier de bracelets cuir. Mécanique de haute précision et maroquinerie fine jouent maintenant de concert.
C’était écrit. Dans les années 1920, Hermès est entré dans l’horlogerie par ses bracelets. Aujourd’hui, ses cuirs entrent en Suisse. Les deux faces de La Montre Hermès, savoir-faire sellier et inventivité horlogère, s’unissent enfin. La firme se donne ainsi les moyens de répondre à la demande croissante de ses clients internationaux et aux commandes spéciales.
Un bracelet Hermès, c’est un ballet de mains, virevoltantes, passionnées, qui travaillent des cuirs vivants, toujours singuliers. Lever de rideau sur une activité très peu décrite dans le milieu horloger, une valse à douze temps.
En prélude, les peaux sont stockées dans un local fermé, à température et hygrométrie constantes. Ce sont les mêmes qui servent à la fabrication des sacs et des selles. Tous les types sont représentés, aussi bien la chèvre, le veau et le buffle que l’autruche ou l’alligator. On reconnaît les noms et la qualité des cuirs maison, le Barénia robuste ou le grain de l’Epsom, et les coloris fins comme le rouge H.
Au premier temps de la valse, la précoupe et l’appairage, soit le prélèvement de deux morceaux apparentés qui formeront les deux parties du bracelet, le sanglon (partie longue à six heures) et le boucleteau (partie courte à douze heures où s'ajustent la boucle et les deux passants). La sélection est rigoureuse, évitant les rides, les veines ou les griffures, et attentive à ce que les deux plaques aient la même teinte, les écailles du croco, par exemple, la même forme et la même taille. Au deuxième temps, la refente (coupe dans le sens de l'épaisseur) et le parage (amincissement des bords en une pente douce et régulière), où l’on affine les peaux trop épaisses. Au troisième temps, le collage, d’abord du viledon, textile assurant la tenue de la pièce, ensuite de la doublure. Les petites manipulations et les instruments de contrôle ont la précision des machines qui les inspirent et qui font la réputation de l’arc jurassien. Au quatrième temps vient la coupe juste. Le cuir amorce sa métamorphose.
Alors entrent en scène les maroquinières, pour le ballet tourbillonnant des finitions. Elles sont multi-instrumentistes et tous leurs outils, de l’aiguille au filet, ont été modifiés, affinés pour le travail des cuirs.
Après le traçage et le griffage, cinquième temps de la valse, c’est-à-dire le marquage du trait et des points de couture, cette dernière s’effectue, temps six, avec un fil de lin et se termine à la main, en trois points d’arrêt aux extrémités: c’est le "piqué sellier". La tranche du bracelet, temps sept, est abat-carrée, grattée, polissée au papier de verre. Elle est teintée, temps huit, lissée, temps neuf, cirée, temps dix, et chaque mouvement se répète. Le filetage, temps onze, le marquage d’une raie entre la couture et le bord du cuir, assouplit le bracelet tout en le rehaussant.
Au dernier temps de la valse, en des gestes plus délicats encore, les deux passants du bracelet, le fixe et le coulant, sont eux aussi coupés, parés, collés, griffés, et encore grattés, teintés, lissés, relissés, cirés, recirés. La figure la plus complexe s’exécute sur le passant fixe, qui est cousu à la main, toujours du même point sellier, l’aiguille papillonnant autour du passant sans le faire bouger.
Au final, la marqueuse authentifie chaque bracelet par une lettre signalant l’année de fabrication du cuir et par une forme géométrique désignant les peaux les plus précieuses. S’imprime enfin la marque de la firme: Hermès.
17 janvier 2007
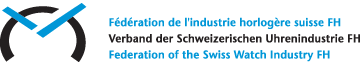

 News
News 




