Le 27 juin dernier, la Convention patronale de l'industrie horlogère suisse (CP) a livré les résultats de son traditionnel recensement qui, pour la première fois en 1999, a été étendu à de nouveaux champs d'investigation. C'est ainsi qu'il a fourni, en plus des effectifs du personnel et des entreprises, le profil des collaborateurs et leur niveau de formation. Les résultats serviront de balises pour guider les futures actions de la CP, notamment dans le domaine de la formation.
Le 30 septembre 1999, 34'655 personnes travaillaient dans l'industrie horlogère et microtechnique, qui a ainsi vu ses effectifs s'étoffer de 441 unités (+ 1,3 %) par rapport à l'année précédente. Pour la seconde année consécutive, la branche a donc créé des places de travail (1'100 en 1998). Cette tendance, qui s'inscrit dans le sillage de la bonne marche des affaires, devrait se consolider encore dans les mois à venir au vu des excellents résultats enregistrés depuis la fin de l'été dernier.
Ces chiffres positifs contrastent avec la légère diminution du nombre d'entreprises recensées qui s'élève à 567 unités (- 14 unités, - 2,4 %). Contraction qui s'explique en partie par le mouvement d'intégration des entreprises.
Il faut cependant relativiser ces variations: en effet, depuis le milieu des années quatre-vingts, les effectifs horlogers fluctuent autour de la barre des 33'000 personnes et on dénombre environ 580 entreprises horlogères. Les oscillations enregistrées en 1999 s'inscrivent donc dans une évolution empreinte de stabilité dans le long terme.
La majeure partie du personnel est occupée dans les entreprises affiliées à la CP et qui sont donc soumises à la Convention collective de travail signée avec les syndicats. Le régime conventionnel concerne en effet 400 entreprises (70,5 % de l'ensemble) occupant 28'280 personnes (81,6 % de l'ensemble).
Plus de 90 % des effectifs sont concentrés sur l'Arc jurassien. Comme en témoignent les chiffres ci-après (en nombre de personnes et en %), Neuchâtel demeure le canton horloger par excellence:
| Neuchâtel | 9'533 | 27,5 % |
| Berne | 6'894 | 19,9 % |
| Genève | 5'130 | 14,8 % |
| Soleure | 3'736 | 10,8 % |
| Jura | 3'345 | 9,7 % |
| Vaud | 2'571 | 7,4 % |
| Bâle-Campagne | 989 | 2,8 % |
| Divers | 2'457 | 7,1 % |
| Total | 34'655 | 100,0 % |
En dehors de l'Arc jurassien, les cantons qui connaissent une activité horlogère significative sont le Tessin (1'086 employés), le Valais (587) et Fribourg (336).
L'industrie horlogère regroupe des entreprises exerçant des activités très variées: cela va de l'assemblage de montres complètes à la fabrication de pièces détachées, en passant par le polissage ou la galvanoplastie, sans oublier les entreprises - nombreuses – qui pratiquent une activité purement tertiaire (vente, représentation). Par ailleurs, près de 30 % des établissements exercent une partie de leur activité dans un domaine qui n'est pas directement lié à l'horlogerie, comme le technico-médical ou la connectique. La fabrication de composants horlogers (bracelet, cadran, etc) est l'activité la plus répandue, suivie par l'assemblage et la terminaison de produits horlogers.
Le tissu industriel horloger est principalement composé de petites structures: trois entreprises sur quatre emploient moins de 50 personnes alors que neuf établissements seulement ont plus de 500 collaborateurs. En moyenne, une entreprise horlogère emploie une soixantaine de personnes.
Hommes (53,5 %) et femmes (46,5 %) se trouvent quasiment en proportion égale dans le milieu horloger. A titre comparatif, les Suissesses représentent globalement 44 % des actifs occupés.
Le caractère industriel de l'horlogerie se retrouve au niveau de la répartition du personnel. En effet, trois employés sur quatre travaillent à la production alors que l'administration n'en emploie qu'un sur cinq. Si le travail à domicile est toujours présent, il est très marginal puisqu'il n'occupe que 2 % des collaborateurs, ou plus exactement… des collaboratrices.
Le nouveau recensement a par ailleurs permis de mieux cerner le niveau de formation des collaborateurs. Plus de la moitié d'entre eux possèdent une formation supérieure ou un diplôme de métiers. L'autre moitié est constituée de personnes semi ou non qualifiées qui travaillent essentiellement à la production.
5 juillet 2000
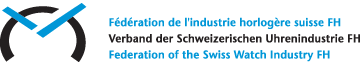

 News
News